La Petite Sirène / Hans Christian Andersen (I)
La Sirène est une créature hybride mythologique, à mettre au rang des prédateurs de la race humaine, du moins de sa moitié masculine.
Wiki nous apprend que la tradition la plus tardive, gréco-romaine, les dote d’abord d’ailes et de plumes. Elles sont déjà des déesses marines, chanteuses et musiciennes ensorcelantes, qui égarent et abîment les bateaux.
 |
| Mosaïque d'Ulysse et les sirènes - ville de Dougga |
.jpg) |
| La sirene repue Gustav-Adolf Mossa (1905) |
 |
| La Sirène et le pêcheur Frederic Leighton (1856-1858) |
.jpg) |
| Dans la mer - Arnold Bocklin (1827 - 1901) |
.jpg) |
| Sirène - John Williams Waterhouse (1900) |
La tradition scandinave préfère les munir d’écailles et d’une queue de poisson (drôlement plus pratique), pour les faire osciller entre le monstre naufrageur et la pucelle effarouchée qui se brosse les cheveux assise sur un rocher.
En 1835, Andersen nous cristallise le mythe à la mode romantique, sous les traits d’une très jeune fille qui rêve du prince charmant et d’une âme catholique immortelle. Elle vibre selon une palette d’émotions qui va de l’affliction au renoncement, en passant par la soumission. Elle soupire, gémit, attend, endure et obéit avec beaucoup de courage, pour finalement se laisser mourir pour convenance personnelle.
 En 1968, Ivan Aksenchuk réalise Rusalochka, la petite sirène (Soyuzmultfilm), dont le charme sera loin d’être égalé par Marina, la petite Sirène (Toei) du réalisateur Tomoharu Katsumata, sorti en 1975 au Japon et 4 ans plus tard en France. Ces deux animés s’inspirent directement de l’œuvre d’Andersen : la vierge pélagique et solitaire va mourir d’amour pour celui qui en aime une autre, puisque, en ce très bas monde, le grand amour ne vient qu’une fois.
En 1968, Ivan Aksenchuk réalise Rusalochka, la petite sirène (Soyuzmultfilm), dont le charme sera loin d’être égalé par Marina, la petite Sirène (Toei) du réalisateur Tomoharu Katsumata, sorti en 1975 au Japon et 4 ans plus tard en France. Ces deux animés s’inspirent directement de l’œuvre d’Andersen : la vierge pélagique et solitaire va mourir d’amour pour celui qui en aime une autre, puisque, en ce très bas monde, le grand amour ne vient qu’une fois. En 1989, Disney donne le rôle à Ariel, plus combative, moins plaintive, mais toujours aussi désespérément contrainte aux mêmes choix : être malheureuse comme un galet ou se marier avec cet homme et aucun autre. Non seulement elle lutte sans presque jamais soupirer ni se résigner, mais en plus elle parvient à ses fins (se marier).
En 1989, Disney donne le rôle à Ariel, plus combative, moins plaintive, mais toujours aussi désespérément contrainte aux mêmes choix : être malheureuse comme un galet ou se marier avec cet homme et aucun autre. Non seulement elle lutte sans presque jamais soupirer ni se résigner, mais en plus elle parvient à ses fins (se marier). En 2008, enfin, Hayao Miyazaki sort Ponyo sur la falaise, une nouvelle lecture du conte qui nous donne de l’air…
En 2008, enfin, Hayao Miyazaki sort Ponyo sur la falaise, une nouvelle lecture du conte qui nous donne de l’air…
Car vous m’aurez comprise : « la petite sirène » est un cliché sur pattes (euh), qui fait du point en matière de sexisme, un trope comme on aime en dézinguer le plus souvent possible par ici. Ce petit historique n’a pas seulement vocation, même si ça compte, à me défouler sadiquement, mais aussi à montrer que le poids de la culture, du temps, de la tradition, n’est pas un mal que l’on doit prendre en patience : à tout moment, n’importe qui peut faire autre chose.
Nous allons donc dépiauter une sardine, une.
Et pour commencer : le conte danois, qui a tout de l’allégorie dramatique de la puberté féminine post-moyenâgeuse, précédemment résumée (mourir ou se marier). Une sirène est un peu comme une petite fille : elle n’a pas de sexe, donc pas de sexualité, à cause de sa queue de poisson. C’est une pucelle. Enfin, c’est une image pour dire qu’on ferait semblant de pas utiliser les vrais mots. Le texte est quand même très clair là-dessus : devenir une femme la fera saigner. Pardon, mais ça, question puberté, c’est un signe qui ne trompe pas. Et accessoirement, ça fera mal (et pas aux pieds, hein), mais c’est un mal nécessaire : maintenant elle doit convoler, sans quoi, après trois jours (l’insoutenable légèreté du papillon…), elle rejoindra le néant d’où elle vient faute d’objet de dévotion. Ce qui, inévitablement et pédagogiquement ne manque pas d’arriver. Sortez vos mouchoirs c’est très beau.
Bonne lecture.
(Illustrations : Bertall, 1820-1882)
(Illustrations : Bertall, 1820-1882)
LA PETITE SIRENE
👇 Vous pouvez écouter cette histoire ! 👇
Bien loin dans la mer, l’eau est bleue comme les feuilles des bluets, pure comme le verre le plus transparent, mais si profonde qu’il serait inutile d’y jeter l’ancre, et qu’il faudrait y entasser une quantité infinie de tours d’églises les unes sur les autres pour mesurer la distance du fond à la surface.
C’est là que demeure le peuple de la mer. Mais n’allez pas croire que ce fond se compose seulement de sable blanc ; non, il y croît des plantes et des arbres bizarres, et si souples, que le moindre mouvement de l’eau les fait s’agiter comme s’ils étaient vivants. Tous les poissons, grands et petits, vont et viennent entre les branches comme les oiseaux dans l’air. À l’endroit le plus profond se trouve le château du roi de la mer, dont les murs sont de corail, les fenêtres de bel ambre jaune, et le toit de coquillages qui s’ouvrent et se ferment pour recevoir l’eau ou pour la rejeter. Chacun de ces coquillages referme des perles brillantes dont la moindre ferait honneur à la couronne d’une reine.
Depuis plusieurs années le roi de la mer était veuf, et sa vieille mère dirigeait sa maison. C’était une femme spirituelle, mais si fière de son rang, qu’elle portait douze huîtres à sa queue tandis que les autres grands personnages n’en portaient que six. Elle méritait des éloges pour les soins qu’elle prodiguait à ses six petites filles, toutes princesses charmantes. Cependant la plus jeune était plus belle encore que les autres ; elle avait la peau douce et diaphane comme une feuille de rose, les yeux bleus comme un lac profond ; mais elle n’avait pas de pieds : ainsi que ses sœurs, son corps se terminait par une queue de poisson.
Toute la journée, les enfants jouaient dans les grandes salles du château, où des fleurs vivantes poussaient sur les murs. Lorsqu’on ouvrait les fenêtres d’ambre jaune, les poissons y entraient comme chez nous les hirondelles, et ils mangeaient dans la main des petites sirènes qui les caressaient. Devant le château était un grand jardin avec des arbres d’un bleu sombre ou d’un rouge de feu. Les fruits brillaient comme de l’or, et les fleurs, agitant sans cesse leur tige et leurs feuilles, ressemblaient à de petites flammes. Le sol se composait de sable blanc et fin, et une lueur bleue merveilleuse, qui se répandait partout, aurait fait croire qu’on était dans l’air, au milieu de l’azur du ciel, plutôt que sous la mer. Les jours de calme, on pouvait apercevoir le soleil, semblable à une petite fleur de pourpre versant la lumière de son calice.
Chacune des princesses avait dans le jardin son petit terrain, qu’elle pouvait cultiver selon son bon plaisir. L’une lui donnait la forme d’une baleine, l’autre celle d’une sirène ; mais la plus jeune fit le sien rond comme le soleil, et n’y planta que des fleurs rouges comme lui. C’était une enfant bizarre, silencieuse et réfléchie. Lorsque ses sœurs jouaient avec différents objets provenant des bâtiments naufragés, elle s’amusait à parer une jolie statuette de marbre blanc, représentant un charmant petit garçon, placée sous un saule pleureur magnifique, couleur de rose, qui la couvrait d’une ombre violette. Son plus grand plaisir consistait à écouter des récits sur le monde où vivent les hommes. Toujours elle priait sa vieille grand’mère de lui parler des vaisseaux, des villes, des hommes et des animaux.
Elle s’étonnait surtout que sur la terre les fleurs exhalassent un parfum qu’elles n’ont pas sous les eaux de la mer, et que les forêts y fussent vertes.
Elle ne pouvait pas s’imaginer comment les poissons chantaient et sautillaient sur les arbres. La grand’mère appelait les petits oiseaux des poissons ; sans quoi elle ne se serait pas fait comprendre.
« Lorsque vous aurez quinze ans, dit la grand’mère, je vous donnerai la permission de monter à la surface de la mer et de vous asseoir au clair de la lune sur des rochers, pour voir passer les grands vaisseaux et faire connaissance avec les forêts et les villes. »
L’année suivante, l’aînée des sœurs allait atteindre sa quinzième année, et comme il n’y avait qu’une année de différence entre chaque sœur, la plus jeune devait encore attendre cinq ans pour sortir du fond de la mer. Mais l’une promettait toujours à l’autre de lui faire le récit des merveilles qu’elle aurait vues à sa première sortie ; car leur grand’mère ne parlait jamais assez, et il y avait tant de choses qu’elles brûlaient de savoir !
La plus curieuse, c’était certes la plus jeune ; souvent, la nuit, elle se tenait auprès de la fenêtre ouverte, cherchant à percer de ses regards l’épaisseur de l’eau bleue que les poissons battaient de leurs nageoires et de leur queue. Elle aperçut en effet la lune et les étoiles, mais elles lui paraissaient toutes pâles et considérablement grossies par l’eau.
Lorsque quelque nuage noir les voilait, elle savait que c’était une baleine ou un navire chargé d’hommes qui nageait au-dessus d’elle. Certes, ces hommes ne pensaient pas qu’une charmante petite sirène étendait au-dessous d’eux ses mains blanches vers la carène.
Le jour vint où la princesse aînée atteignit sa quinzième année, et elle monta à la surface de la mer.
À son retour, elle avait mille choses à raconter. « Oh ! disait-elle, c’est délicieux de voir, étendue au clair de la lune sur un banc de sable, au milieu de la mer calme, les rivages de la grande ville où les lumières brillent comme des centaines d’étoiles ; d’entendre la musique harmonieuse, le son des cloches des églises, et tout ce bruit d’hommes et de voitures ! »
Oh ! comme sa petite sœur l’écoutait attentivement ! Tous les soirs, debout à la fenêtre ouverte, regardant à travers l’énorme masse d’eau, elle rêvait à la grande ville, à son bruit et à ses lumières, et croyait entendre sonner les cloches tout près d’elle.
L’année suivante, la seconde des sœurs reçut la permission de monter. Elle sortit sa tête de l’eau au moment où le soleil touchait à l’horizon, et la magnificence de ce spectacle la ravit au dernier point.
« Tout le ciel, disait-elle à son retour, ressemblait à de l’or, et la beauté des nuages était au-dessus de tout ce qu’on peut imaginer. Ils passaient devant moi, rouges et violets, et au milieu d’eux volait vers le soleil, comme un long voile blanc, une bande de cygnes sauvages. Moi aussi j’ai voulu nager vers le grand astre rouge ; mais tout à coup il a disparu, et la lueur rose qui teignait la surface de la mer ainsi que les nuages s’évanouit bientôt. »
Puis vint le tour de la troisième sœur. C’était la plus hardie, aussi elle remonta le cours d’un large fleuve. Elle vit d’admirables collines plantées de vignes, de châteaux et de fermes situés au milieu de forêts superbes. Elle entendit le chant des oiseaux, et la chaleur du soleil la força à se plonger plusieurs fois dans l’eau pour rafraîchir sa figure. Dans une baie, elle rencontra une foule de petits êtres humains qui jouaient en se baignant. Elle voulut jouer avec eux, mais ils se sauvèrent tout effrayés, et un animal noir — c’était un chien — se mit à aboyer si terriblement qu’elle fut prise de peur et regagna promptement la pleine mer. Mais jamais elle ne put oublier les superbes forêts, les collines vertes et les gentils enfants qui savaient nager, quoiqu’ils n’eussent point de queue de poisson.
La quatrième sœur, qui était moins hardie, aima mieux rester au milieu de la mer sauvage, où la vue s’étendait à plusieurs lieues, et où le ciel s’arrondissait au-dessus de l’eau comme une grande cloche de verre. Elle apercevait de loin les navires, pas plus grands que des mouettes ; les dauphins joyeux faisaient des culbutes, et les baleines colossales lançaient des jets d’eau de leurs narines.
Le tour de la cinquième arriva ; son jour tomba précisément en hiver : aussi vit-elle ce que les autres n’avaient pas encore pu voir. La mer avait une teinte verdâtre, et partout nageaient, avec des formes bizarres, et brillantes comme des diamants, des montagnes de glace. « Chacune d’elles, disait la voyageuse, ressemble à une perle plus grosse que les tours d’église que bâtissent les hommes. » Elle s’était assise sur une des plus grandes, et tous les navigateurs se sauvaient de cet endroit où elle abandonnait sa longue chevelure au gré des vents. Le soir, un orage couvrit le ciel de nuées ; les éclairs brillèrent, le tonnerre gronda, tandis que la mer, noire et agitée, élevant les grands monceaux de glace, les faisait briller de l’éclat rouge des éclairs. Toutes les voiles furent serrées, la terreur se répandit partout ; mais elle, tranquillement assise sur sa montagne de glace, vit la foudre tomber en zigzag sur l’eau luisante.
La première fois qu’une des sœurs sortait de l’eau, elle était toujours enchantée de toutes les nouvelles choses qu’elle apercevait ; mais, une fois grandie, lorsqu’elle pouvait monter à loisir, le charme disparaissait, et elle disait au bout d’un mois qu’en bas tout était bien plus gentil, et que rien ne valait son chez-soi.
Souvent, le soir, les cinq sœurs, se tenant par le bras, montaient ainsi à la surface de l’eau. Elles avaient des voix enchanteresses comme nulle créature humaine, et, si par hasard quelque orage leur faisait croire qu’un navire allait sombrer, elles nageaient devant lui et entonnaient des chants magnifiques sur la beauté du fond de la mer, invitant les marins à leur rendre visite. Mais ceux-ci ne pouvaient comprendre les paroles des sirènes, et ils ne virent jamais les magnificences qu’elles célébraient ; car, aussitôt le navire englouti, les hommes se noyaient, et leurs cadavres seuls arrivaient au château du roi de la mer.
Pendant l’absence de ses cinq sœurs, la plus jeune, restée seule auprès de la fenêtre, les suivait du regard et avait envie de pleurer. Mais une sirène n’a point de larmes, et son cœur en souffre davantage.
« Oh ! si j’avais quinze ans ! disait-elle, je sens déjà combien j’aimerais le monde d’en haut et les hommes qui l’habitent. »
Le jour vint où elle eut quinze ans.
« Tu vas partir, lui dit sa grand’mère, la vieille reine douairière : viens que je fasse ta toilette comme à tes sœurs. »
Et elle posa sur ses cheveux une couronne de lis blancs dont chaque feuille était la moitié d’une perle ; puis elle fit attacher à la queue de la princesse huit grandes huîtres pour désigner, son rang élevé.
« Comme elles me font mal ! dit la petite sirène.
— Si l’on veut être bien habillée, il faut souffrir un peu, » répliqua la vieille reine.
Cependant la jeune fille aurait volontiers rejeté tout ce luxe et la lourde couronne qui pesait sur sa tête. Les fleurs rouges de son jardin lui allaient beaucoup mieux ; mais elle n’osa pas faire d’observations.
« Adieu ! » dit-elle ; et, légère comme une bulle de savon, elle traversa l’eau.
Lorsque sa tête apparut à la surface de la mer, le soleil venait de se coucher ; mais les nuages brillaient encore comme des roses et de l’or, et l’étoile du soir étincelait au milieu du ciel. L’air était doux et frais, la mer paisible. Près de la petite sirène se trouvait un navire à trois mâts ; il n’avait qu’une voile dehors, à cause du calme, et les matelots étaient assis sur les vergues et sur les cordages. La musique et les chants y résonnaient sans cesse, et à l’approche de la nuit on alluma cent lanternes de diverses couleurs suspendues aux cordages : on aurait cru voir les pavillons de toutes les nations. La petite sirène nagea jusqu’à la fenêtre de la grande chambre, et, chaque fois que l’eau la soulevait, elle apercevait à travers les vitres transparentes une quantité d’hommes magnifiquement habillés. Le plus beau d’entre eux était un jeune prince aux grands cheveux noirs, âgé d’environ seize ans, et c’était pour célébrer sa fête que tous ces préparatifs avaient lieu.
Les matelots dansaient sur le pont, et lorsque le jeune prince s’y montra, cent fusées s’élevèrent dans les airs, répandant une lumière comme celle du jour. La petite sirène eut peur et s’enfonça dans l’eau ; mais bientôt elle reparut, et alors toutes les étoiles du ciel semblèrent pleuvoir sur elle. Jamais elle n’avait vu un pareil feu d’artifice ; de grands soleils tournaient, des poissons de feu fendaient l’air, et toute la mer, pure et calme, brillait. Sur le navire on pouvait voir chaque petit cordage, et encore mieux les hommes. Oh ! que le jeune prince était beau ! Il serrait la main à tout le monde, parlait et souriait à chacun tandis que la musique envoyait dans la nuit ses sons harmonieux.
Il était tard, mais la petite sirène ne put se lasser d’admirer le vaisseau et le beau prince. Les lanternes ne brillaient plus et les coups de canon avaient cessé ; toutes les voiles furent successivement déployées et le vaisseau s’avança rapidement sur l’eau. La princesse le suivit, sans détourner un instant ses regards de la fenêtre. Mais bientôt la mer commença à s’agiter ; les vagues grossissaient, et de grands nuages noirs s’amoncelaient dans le ciel. Dans le lointain brillaient les éclairs, un orage terrible se préparait. Le vaisseau se balançait sur la mer impétueuse, dans une marche rapide. Les vagues, se dressant comme de hautes montagnes, tantôt le faisaient rouler entre elles comme un cygne, tantôt l’élevaient sur leur cime. La petite sirène se plut d’abord à ce voyage accidenté ; mais, lorsque le vaisseau, subissant de violentes secousses, commença à craquer, lorsque tout à coup le mât se brisa comme un jonc, et que le vaisseau se pencha d’un côté tandis que l’eau pénétrait dans la cale, alors elle comprit le danger, et elle dut prendre garde elle-même aux poutres et aux débris qui se détachaient du bâtiment.
Par moments il se faisait une telle obscurité, qu’elle ne distinguait absolument rien ; d’autres fois, les éclairs lui rendaient visibles les moindres détails de cette scène. L’agitation était à son comble sur le navire ; encore une secousse ! il se fendit tout à fait, et elle vit le jeune prince s’engloutir dans la mer profonde. Transportée de joie, elle crut qu’il allait descendre dans sa demeure ; mais elle se rappela que les hommes ne peuvent vivre dans l’eau, et que par conséquent il arriverait mort au château de son père. Alors, pour le sauver, elle traversa à la nage les poutres et les planches éparses sur la mer, au risque de se faire écraser, plongea profondément sous l’eau à plusieurs reprises, et ainsi elle arriva jusqu’au jeune prince, au moment où ses forces commençaient à l’abandonner et où il fermait déjà les yeux, près de mourir. La petite sirène le saisit, soutint sa tête au-dessus de l’eau, puis s’abandonna avec lui au caprice des vagues.
Le lendemain matin, le beau temps était revenu, mais il ne restait plus rien du vaisseau. Un soleil rouge, aux rayons pénétrants, semblait rappeler la vie sur les joues du prince ; mais ses yeux restaient toujours fermés. La sirène déposa un baiser sur son front et releva ses cheveux mouillés. Elle lui trouva une ressemblance avec la statue de marbre de son petit jardin, et fit des vœux pour son salut. Elle passa devant la terre ferme, couverte de hautes montagnes bleues à la cime desquelles brillait la neige blanche. Au pied de la côte, au milieu d’une superbe forêt verte, s’étendait un village avec une église ou un couvent. En dehors des portes s’élevaient de grands palmiers, et dans les jardins croissaient des orangers et des citronniers ; non loin de cet endroit, la mer formait un petit golfe, s’allongeant jusqu’à un rocher couvert d’un sable fin et blanc. C’est là que la sirène déposa le prince, ayant soin de lui tenir la tête haute et de la présenter aux rayons du soleil.
Bientôt les cloches de l’église commencèrent à sonner, et une quantité de jeunes filles apparurent dans un des jardins. La petite sirène s’éloigna en nageant, et se cacha derrière quelques grosses pierres pour observer ce qui arriverait au pauvre prince.
Quelques moments après, une des jeunes filles vint à passer devant lui ; d’abord, elle parut s’effrayer, mais, se remettant aussitôt, elle courut chercher d’autres personnes qui prodiguèrent au prince toute espèce de soins. La sirène le vit reprendre ses sens et sourire à tous ceux qui l’entouraient ; à elle seule il ne sourit pas, ignorant qui l’avait sauvé. Aussi, lorsqu’elle le vit conduire dans une grande maison, elle plongea tristement et retourna au château de son père.











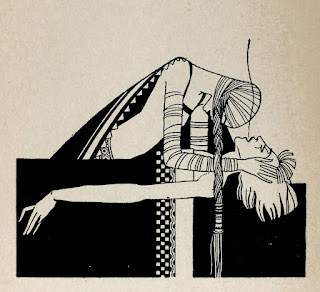
Commentaires
Enregistrer un commentaire
Les commentaires sont modérés. Je validerai manuellement et répondrai à votre message dès que possible !